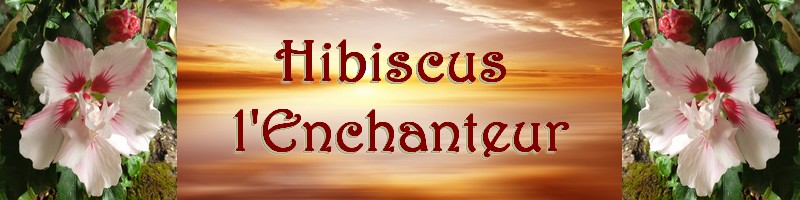DIX FRAGMENTS SUR BLAKE
Lire Blake, c’est avoir le visage aspergé par une eau
qui jaillit d’une fontaine inépuisable de beauté. William Butler Yeats
(«William Blake et l’imagination», 1897)
Il entendait chanter les anges. Il en rencontrait souvent sur sa route, et des
démons aussi. Jusqu’à sa mort, il s’entretint régulièrement avec son jeune frère
Robert, dont il avait achevé l’éducation à la mort de leur père, et qui mourut
prématurément. Dans sa chambre il reçut plus d’une fois la visite de Milton,
qu’il admirait et auquel il ne ménagea pas ses remontrances et ses reproches
pour avoir suivi de trop près la Bible en donnant de la Femme une image
inférieure, servile et coupable. Certains jours, William Blake se croyait au
Paradis ; ou plutôt, il y était déjà, car le Paradis était fait pour lui de toutes
choses vivantes, et tout ce qui vivait possédait à un degré éminent la sainteté. Si
l’un ou l’autre des traits que je viens d’énoncer choquent ceux qui m’écoutent, il
ne faut pas qu’ils lisent William Blake : ils peuvent aimer superficiellement ses
gravures mais ils ne les comprendront jamais et sa poésie n’est pas faite pour
eux. Pour aimer Blake, il faut laisser de côté et même refuser obstinément un
certain nombre de choses qui ont commencé de son temps, et qui ont presque
gagné la partie dans le monde où nous vivons. Contre elles, il aura passé toute sa
vie à se battre avec les moyens à la fois dérisoires et sublimes qu’offrent la
plume, les encres de toutes les couleurs, et les pointes à graver. Ou plutôt avec
cet unique moyen qu’est la Pensée, mais la Pensée complète, qui n’est pas pour
lui esprit plutôt que matière, âme plutôt que corps, mais les deux pensant
ensemble, indissolublement. Pensant à la pauvreté dans laquelle vécut Blake, je
songe à son contemporain Beethoven répondant à son neveu Karl qui lui avait
envoyé une carte de visite ridicule où il se présentait comme un « propriétaire
foncier » : « Luwig van Beethoven, propriétaire d’un cerveau ». Blake et
Beethoven, si différents qu’ils soient, ont un grand point commun : ce sont de
farouches servants de la liberté. Cette liberté immense nous semble aujourd’hui
au-dessus de nos forces. Elle exige de comprendre que l’homme est d’essence
divine.
▼
Quelles sont ces choses que Blake refuse ? Le matérialisme, le
rationalisme qui est une compréhension trop étroite de la raison, l’esprit
techniciste des Lumières. Tout ce qui, en dépit du romantisme, n’a cessé de
renforcer son emprise sur notre monde.
Pour comprendre Blake, il faut et il suffit d’accéder, à force de le lire, à la
définition implicite de l’homme que propose son œuvre : l’homme n’est pas une
créature supérieure à la fleur ou au ver de terre, mais il est celui qui dans la
création est en charge de tout ce qui est, parce qu’il possède la faculté de
l’imagination, qui lui permet de poursuivre l’œuvre de la création.
L’Imagination est la reine des facultés : elle est en l’homme la signature de
Dieu, la preuve que l’être humain a été créé à son image. L’imagination est la
faculté du possible. Elle existe en dehors de l’homme (le monde entier est
image, ses formes naissent d’une puissance continue d’invention qui est au cœur
de la Nature créatrice), mais l’homme y participe par tout le sommet de son
être : il a reçu le pouvoir de créer à son tour. La poésie, la peinture, la sculpture,
représentent l’exercice conscient de ce pouvoir qui s’exerce en chaque homme
de façon inconsciente par les moyens du Rêve. La poésie de Blake, à l’orée du
romantisme, la première grande protestation de l’Esprit européen contre tout ce
qui dans le monde moderne pourtant issu de ce même Esprit – et c’en est tout le
paradoxe et toute la tragédie –, asservit et détruit l’humain. Et cette protestation
passe avant tout par le Rêve.
▼
Blake est le contemporain de la Révolution industrielle, la véritable
grande Révolution qui précède un peu, prolonge et excède la Révolution
française, assure le triomphe de la bourgeoisie, et accomplit un bouleversement
radical de la société qui aboutira à la disparition définitive du monde paysan, et
qui mettra deux siècles à s’accomplir, à révéler les ultimes conséquences que
nous observons à présent autour de nuit. C’est ce bouleversement qu’il
prophétise, car il est plus urgent pour lui d’être prophète que d’être poète, et sa
poésie en a sans doute parfois payé le prix. Keats, lui, avec la même conscience,
restera fidèle exclusivement à sa tâche de poète. Blake, lui, est pétri de
philosophie : autodidacte, courant sans peur le risque d’être confus, et pourtant
de ce fait même libre de tout asservissement à la philosophie officielle, capable
de ramener de ses explorations dans le monde des Idées des éclairs de vision qui
illuminent la Caverne. Est-il besoin de préciser qu’il est radicalement
platonicien ?
▼
Blake assiste donc à la révolution industrielle, c’est-à-dire d’abord à la
mécanisation des filatures, dont la conséquence directe est l’asservissement des
femmes et surtout des enfants à la toute-puissance de la Machine : on les
emploie dans les filatures parce que seuls des êtres de petite taille peuvent se
glisser sous les métiers mécaniques pour mettre et remettre en place les fils, à la
fin de la bobine ou quand le fil a cassé. Cette mécanisation de l’humain est la
conséquence directe, matérielle, tangible, du rationalisme technologique des
Lumières. C’est le début du règne du Progrès. Non pas la fin de l’esclavage,
comme l’avait cru Aristote, mais un esclavage d’un autre ordre qui n’arrache
l’homme à la glèbe que pour faire de lui un prolongement des bras et des
rouages terrifiants de la mécanique infernale qui ne dort jamais. L’usine, qui
tourne sans s’arrêter, refuse par essence le rêve. Elle tue chez l’être forcé d’y
travailler pour se nourrir la possibilité même de rêve ; et ainsi, elle déshumanise
l’homme. La poésie de Blake, dès les Chants de l’innocence puis dans les
Chants de l’expérience, naît sous le signe d’une protestation contre cette
évolution irréversible. Cette protestation n’est pas moins nécessaire aujourd’hui.
▼
L’Imagination n’est pas le contraire de la Raison, ni autre chose que la
Raison ; c’est la Raison qui est une partie de l’Imagination. Telle est la
Révélation blakienne, et le renversement copernicien qu’il opère entre les deux
entités : réduire l’homme à ses facultés rationnelles, c’est ne pas voir qu’on
pense toujours à partir des images et non pas contre elles. Descartes, pourtant si
fasciné par le rêve et les songes, mais qui redoutait leur puissance trompeuse et,
du même mouvement, tout ce qui nous vient de l’enfance, avait chassé des terres
de la pensée l’imagination, « la Folle du logis » ; Blake réinstalle cette souillon
fantasque à la place de reine. C’est ce qui donne à la poésie cet air enfantin, car
l’imagination n’est jamais si vive que dans l’enfance, elle a produit les mythes,
qui sont les contes de l’enfance de l’humanité. Puis le travail de la Raison a
appauvri les mythes, tué les dieux, refermé le Ciel. Il faut donc réenchanter
l’univers : c’est le projet poétique de Blake. Il réhabilite, l’un des premiers avant
le romantisme, l’enfance comme pouvoir perpétuel d’invention, force magique
dont l’homme devenu adulte et libre de ses choix doit augmenter en lui et
purifier la redoutable puissance. Ce n’est donc pas qu’il faille nier la pensée
rationnelle, la dialectique : bien au contraire. La dialectique est libératrice. Mais
les concepts ne peuvent pas tout. Ils ne donnent pas accès au sommet de
l’échelle de Jacob par laquelle l’Eternel descend défier l’être qui a commencé de
s’élever vers lui – et tant mieux si l’élu en demeure à jamais blessé d’amour
irrémédiable, et boitant d’un pas d’élégie. Seule l’Imagination, prenant le relais
de la Raison, peut vraiment mettre en marche les forces suprêmes de l’Esprit.
▼
Blake crée autour de lui pour toujours un « collège invisible ». Les esprits
qui se reconnaissent dans son œuvre (sans forcément tout apprécier de lui)
constituent une sorte de société secrète. Pour moi, cette compagnie quasi
clandestine a été plus particulièrement représentée par quelques visages :
j’évoquerai Kathleen Raine et Pierre Leyris. Il faut bien sûr y joindre au moins
Yeats, qui était avec Blake le trait d’union entre nous, et que bien sûr je n’ai pas
connu, mais que j’ai traduit avec leurs encouragements.
Sans Kathleen Raine je n’aurais sans doute pas été conduit à lire Blake
comme je l’ai fait, ni surtout à le comprendre, je n’aurais pas traduit Yeats, je
n’aurais pas rencontré Pierre Leyris. Je n’ai jamais traduit Blake parce que
Leyris le faisait admirablement. Je me suis concentré sur Yeats, mais Yeats est
le poète à qui l’on doit (avec Swinburne) la redécouverte, en fait la véritable
découverte de William Blake, à l’extrême fin du XIXe siècle. Les deux William :
affinités profondes, celles de deux serviteurs de l’Esprit.
▼
Si Blake a choisi l’épopée c’est parce qu’il est le poète d’une guerre. Car
guerre il y a, et c’est la guerre de l’esprit, non pas contre la matière, car la
matière comme toute chose réelle est sainte et bienfaisante, mais contre le
matérialisme qui ne comprend rien à l’essence de la matière, et qui éteint en elle
toute lumière. La matière est esprit, le dualisme n’a pas de sens entre deux. Le
corps est âme et l’âme est corps.
Le danger est de réduire l’univers épique de Blake au dictionnaire
mythologique qui se chargerait de l’expliquer, ce qu’on peut faire tout aussi
trompeusement avec Wagner – le mot injuste de Debussy le dit bien, qui, un jour
d’humeur antiwagnérienne excusable de sa part seulement, appela la Tétralogie
« le Bottin des dieux ». Ce faisant, on réduit les symboles à des allégories, et
l’on perd l’essentiel. Et à supposer qu’il soit utile ou inévitable de passer par ce
stade de lecture (encore n’est-ce pas certain), il faut savoir le dépasser. Chez
Blake, les quatre Zoas sont les quatre formes de la spiritualité humaine : oui,
Urizen représente la Raison étroite, le rationalisme borné ; Los au contraire (son
ennemi) est la poésie, parole divine déposée en l’homme, imagination créatrice
figurée comme un démiurge-forgeron. Tharmas est le matérialisme
(conséquence de l’activité desséchante du rationalisme), et Urthonah le spectre
chthonien de Los, son incarnation fantomatique sur la Terre. Autres personnages
qui entourent les quatre Zoas : Enitharmon est la Beauté, épouse de Los. Ils ont
des enfants : parmi eux, Orc – anagramme de Cor – « représente » l’énergie
révolutionnaire qui sera, comme Prométhée, enchaînée sur une montagne après
avoir produit la Révolution américaine et la Révolution française, tout en
conservant intacte la puissance de son imagination. Los, son père, a édifié
Golgonooza, une cité spirituelle qui est et n’est pas Londres : qui est seulement
la Londres des esprits créateurs, celle des peintres, des poètes, des artistes et des
savants.
Toute cette mythologie est dominée par Luvah (Love), l’Amour, qui
contient toutes les émotions (l’Amour contient même la Haine, Blake est en
avance de cent ans sur Freud). Son émanation féminine est Vala, la Voilée, la
déesse de la Nature ; elle est la mère d’Urizen, qui l’a trahie. Et puis il y a
Beulah, la Terre promise, et Albion, un géant qui a conquis l’Angleterre et qui
incarne ses réveils et ses assoupissements.
Une fois qu’on a dit cela, on a fourni une sorte de catalogue, ici bien
incomplet : mais le monde Blake n’est pas cette collection de figures
mythologiques, car ces figures vivent, avec leur force symbolique propre. Thel,
par exemple, fille des Séraphins, c’est l’âme, mais c’est tout le destin de cette
âme, sa place dans la nature, qui est déterminée par son alliance avec un corps
mortel. On n’épuise pas les poèmes sur Thel est les « traduisant » en langage
clair. Mais il faut pour le comprendre accepter de ne pas réduire le symbole à
une allégorie.
▼
« Choses grandes et belles », c’est l’incipit et le titre d’un poème de
Yeats, qui est un poème-catalogue. Chacun peut dresser pour son propre une
liste du même genre. Je compterai pour ma part au nombre des choses grandes et
belles de ma vie, « beautiful lofty things », le souvenir de Kathleen Raine
commentant un poème de Blake, assise sous la gravure de Samuel Palmer « La
Tour solitaire », devant une baie vitrée donnant sur un jardin de Londres rempli
d’oiseaux. Elle avait cultivé en elle la force spirituelle et elle avait pénétré au
plus profond de la pensée de Blake qu’elle savait rendre lumineuse. Il ne
subsistait plus aucune obscurité dans le poème, non pas parce qu’elle l’avait
traduit en langage clair, mais parce qu’elle l’avait allumé comme une lampe et
qu’il n’y avait plus qu’à le regarder briller. Kathleen Raine a écrit sur Blake les
livres et les articles les plus justes qui soient ; qui veut comprendre Blake n’a
qu’à se laisser guider par elle, par sa lecture certes savante, mais toujours
poétique, le contraire même de l’érudition académique qui se déploie pour elle-
même. Qu’on aime ou non Blake autant qu’elle (je ne suis pas sûr de le placer
absolument aussi haut dans la hiérarchie des poètes qu’elle le faisait), la
différence entre le commentaire qu’elle donnait de l’œuvre de Blake ou de Yeats
et un commentaire de type « positif » comme celui que pratique la critique
anglo-saxonne est la suivante : elle lit Blake et Yeats en se demandant si ce
qu’ils disent est vrai ou non, et en quoi cela peut transformer le regard que nous
portons sur le monde. Seule l’anthropologie de l’imaginaire fondée en France
par Gilbert Durand, et appliquée par Danièle Chauvin1 à la lecture de Blake,
peut rendre compte des enjeux existentiels de cette transformation et approcher
du mystère de la construction poétique d’une œuvre. Car la création n’est pas
l’ennemi de la critique mais ce qui appelle une critique compréhensive, capable
de discerner aussi ce qui, dans tant d’œuvres de Blake, en a interdit la poursuite.
La lecture positive (positiviste) est incapable de saisir là autre chose que des
1
Danièle Chauvin : L’œuvre William Blake, apocalypse et transfiguration. Grenoble, Ellug, 1992.
faits froidement disséqués renvoyant à d’autres faits, à un contexte, à des
contingences.
Kathleen Raine n’était nullement universitaire. Il n’y a rien d’étonnant à
ce que ses livres sur Blake, dont deux pourtant ont été traduits en français2, ne
soient même pas cités dans le catalogue de l’Exposition du Petit Palais, si riche
par ailleurs en informations, mais avant tout conçu par des spécialistes
académiques. Ces ouvrages ne figurent même pas dans la bibliographie. Il n’y a
pas à s’en étonner : c’est dans l’ordre des choses. Le collège invisible mérite
bien son nom.
▼
Pierre Leyris avait formé le projet, avec Jacques Blondel, de traduire en
français toute la poésie de Blake : il n’est pas arrivé au bout de son entreprise. Je
le revois, tout indigné, me dire qu’on lui avait expliqué, après quatre volumes
d’Œuvres parus aux éditions Aubier, qu’il n’y en aurait pas de cinquième parce
qu’on avait « perdu assez d’argent avec Monsieur Black ». Il put poursuivre sa
tâche grâce à la librairie José Corti, où Bertrand Fillaudeau accueillit ensuite bon
nombre de ses traductions et publia, après sa mort, le livre personnel qu’il avait
très tardivement consenti à esquisser après avoir obstinément refusé, toute sa
vie, d’être autre chose qu’un traducteur. Mais le temps ou l’envie ont manqué à
Pierre Leyris pour achever de traduire la totalité de l’œuvre de Blake, et il faut
espérer qu’Armand Himy, après avoir écrit tout récemment la meilleure
biographie de Blake dont on dispose en français3, puisse enfin nous donner une
traduction complète de la Jérusalem dont Leyris n’a traduit que des extraits.
Il y avait en Pierre Leyris une flamme vive que la conversation sur ses
auteurs favoris rallumait infailliblement. Je parlerai un jour des visites que je lui
fis à Meudon, où il vivait avec sa femme dans une grande maison remplie de
livres, rue de la République. Quand on lui parlait de son œuvre, il répondait,
sans doute avec raison, que seuls les auteurs ont une œuvre et qu’un tel mot
employé à propos d’un traducteur était tout à fait déplacé. Avec raison, dis-je,
mais si un traducteur n’a par définition pas d’œuvre propre, les traductions d’un
traducteur tel que Pierre Leyris, envers lesquels lui-même n’était souvent pas
tendre dès lors qu’à l’occasion d’une réédition il était amené à les reprendre et à
les réviser, forment malgré tout une sorte de constellation du même ordre que les
livres préférés d’un grand lecteur : nos préférences, pour reprendre un mot cher
à Julien Gracq, tracent les contours d’une personnalité. Blake est au centre de la
constellation que forment les auteurs traduits par Pierre Leyris ; parmi eux,
Kathleen Raine et Yeats, bien sûr, mais aussi par exemple Michel Ange, vers
L’imagination créatrice de William Blake, trad. sous la dir. de Jacqueline Genet, Paris, Berg International, coll.
« L’Ile verte », 1982 (cet ouvrage est une traduction partielle de Blake and Tradition, Princeton University
Press,1962) ; et, plus accessible au lecteur non averti, William Blake, trad. N. Tisserand et M. Oriano, Paris, éd.
du Chëne, 1975 (éd. originale Londres, Thames and Hudson, 1970).
3Armand Himy : William Blake, Paris, Fayard, 2008.
2
lequel il alla parce que Blake l’admirait et parce qu’il avait su discerner en lui,
infailliblement, la saveur particulière qui s’attache à ceux qui ont fréquenté la
pensée néoplatonicienne.
Pierre Leyris, c’est certain, a sa chaise réservée à la table du collège
invisible. Il est dans notre langue au vingtième siècle l’une des incarnations
éminentes de ce personnage « invisible » de la vie des lettres, le traducteur. Il
était mort depuis peu de temps lorsque je tombai, en visitant à Venise
l’exposition Balthus au Palazzo Grassi4, sur le portrait que Balthus fit de Pierre
et Betty Leyris au temps où, tout jeune peintre, en 1932, il partageait leur
appartement à Paris. Qu’on me permettre de l’évoquer ici, sans m’attarder sur
l’émotion qu’il y a à découvrir le visage qu’avaient dans leur jeunesse deux
personnes qu’on a connues âgées et dont on se souvient avec affection. Pierre est
représenté en veste noire, en train de fumer la pipe, assis, en train de rêver.
Betty, derrière lui, joue au bilboquet.
Il y a dans ce tableau toutes les allusions qu’on veut à l’amour de ces deux
êtres l’un pour l’autre, et aux jeux charnels d’un jeune couple : l’érotisme du
bilboquet, dont la symbolique n’est pas un mystère, est bien dans la manière de
Balthus. Mais j’y vois pour ma part autre chose encore. Le traducteur se livre à
sa rêverie, et il est permis de contempler dans cette jeune femme à la fois
sérieuse et joueuse qui se tient derrière lui une image de sa conscience
linguistique et l’âme même de son travail. Betty Leyris, qui ne perdit jamais tout
à fait son délicieux accent britannique, était aussi Anglaise qu’on peut l’être, et
d’une exquise amabilité. Le jeu auquel elle se livre (et où il y a du plaisir, oui),
c’est l’analogue de ce jeu périlleux de la traduction : il faut que cela tombe juste,
et pour cela il faut à l’esprit agilité, souplesse, mobilité. Et que cela tombe juste,
d’un mouvement heureux, c’est à chaque fois un petit miracle, qui ne saurait se
produire à tous coups. Mais il y a un secret ultime de ce jeu : c’est qu’il est,
4
Le catalogue de cette exposition, dû à Jean Clair, a paru chez Flammarion en 2001. Pierre Leyris est mort le 4
janvier 2001, Balthus un peu plus d’un mois plus tard le 18 février. L’exposition du Palazzo Grassi s’est ouverte
à Venise le 9 septembre suivant.
précisément, un jeu, et qu’il n’est pas d’autre moyen d’y devenir habile que de
toujours recommencer.
▼
Lire Blake, regarder ses gravures – ses « fresques », puisqu’il aimait les
présenter ainsi – qu’est-ce que cela signifie ? S’il faut respecter l’esprit dans
lequel il œuvra, et qui n’est pas si éloigné d’une tentative de traduction (à ceci
près que ce qui est à traduire n’est pas un texte préexistant, mais une vision),
c’est, je crois, prendre appui sur la matérialité de ces réalisations souvent
fragmentaires, abandonnées, pour s’élancer vers la vision. Certains jours, Blake
voyait le monde entièrement rénové ; il avait la vision prophétique de ce que
Rimbaud, bien longtemps après lui, appellera « le nouvel amour ». On ose à
peine comparer Rimbaud à quelque autre poète que ce soit, et j’oserai pourtant
dire que plus d’une fois, en lisant Blake, il me semble éprouver comme une
prémonition de ce qu’allait accomplir Rimbaud, demandant à la poésie
d’inventer « le nouvel amour ». Rimbaud esquissant une réécriture de l’Évangile
de Jean dans ce que l’on appelle souvent ses « proses évangéliques » n’est pas si
éloigné de Blake s’efforçant, quatre ou cinq générations avant lui, de mettre au
jour « l’évangile éternel » par tous les moyens de la réécriture. Il ne faut pas
forcer le parallèle, sans doute, mais il est tentant de l’esquisser, jusqu’à certaines
des chansons de Blake qui semblent annoncer les « chansons néantes » de
Rimbaud. L’un des sens possibles du titre des Illuminations ne renvoie-t-il pas à
ce que désigne ce mot en anglais, des gravures du genre de celles de Blake ? À
ceci près, bien sûr, qui n’est pas mince, que la force rénovée de la parole suffit à
Rimbaud là où Blake a, justement, besoin de l’image : une image qui toutefois
vaut davantage parce qu’elle donne à pressentir que par ce qu’elle montre
effectivement ; ou plutôt, qui ne montre que pour éveiller chez celui qui la
regarde le pouvoir de vision, en un mot pour que s’ouvre, par-delà les yeux de
chair, l’œil de l’esprit. Tous deux ont fait dans leur chair et leur âme
l’expérience de l’Enfer, et souhaité rouvrir à l’homme les portes du Paradis.
Tous deux ont cru devoir et pouvoir ouvrir en l’homme « les portes de la
perception », cette expression de Blake qui s’applique si bien à une part (mais à
une part seulement, et vite dépassée), du parcours de Rimbaud, et que le titre de
Huxley lie un peu trompeusement à l’usage des hallucinogènes (auxquels Blake,
que l’on sache, n’eut jamais recours).
Que ce projet me paraisse plus accompli, plus triomphal, plus définitif
chez Rimbaud dont l’abandon de la poésie ne peut être simplement qualifié
d’échec ou de renoncement sans considérer la splendeur des résultats mis au jour
(mais fragmentaires, mais eux aussi abandonnés, eux aussi clandestins et offerts
avant tout à l’avenir), cela tient sans doute, précisément, à ce que Rimbaud joue
toute son existence sur les mots du poème alors que Blake fait d’eux un
tremplin, malgré tout, vers un au-delà du sensible, un monde hors du monde, et
au nom de cela les complète ou les prolonge ou les accompagne d’images.
Il n’empêche ; c’est à partir de Blake en Angleterre comme, en France, à
partir de Baudelaire, de Nerval et de Rimbaud, que la poésie cesse d’être un
discours pour devenir le jaillissement d’une source puisée à même l’expérience
la plus intime de l’âme humaine. Notre époque a toutes les raisons de la refuser
puisque, si elle en comprenait non pas seulement l’ambition mais la réalité
vivante, elle se trouverait renvoyée à son néant spirituel. Pourtant la parole
chemine, elle réveille les esprits, elle nous rappelle que nous sommes
irréductibles à notre capacité de production ou à notre valeur marchande ; elle
nous libère. Je le redis ici : si Blake mérite le nom de poète c’est parce qu’il s’est
voué exclusivement, avec ses moyens propres, à entretenir la petite étincelle
divine qui sommeille au cœur de l’homme – celle-là même que Schiller appelle
la Joie.
Jean-Yves Masson
Texte inédit commandé par la Mel à l’occasion de la rencontre du 16 mai 2009
http://www.m-e-l.fr/medias/extraits-textes/w.blake-jy.masson.pdf